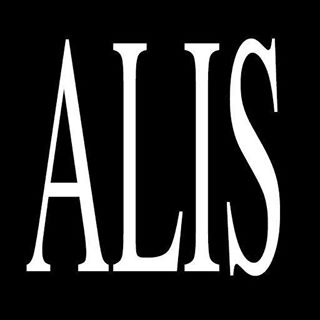POURQUOI UNE RENCONTRE AVEC DES ARCHÉOLOGUES ?
Maintenant le passé,
cette injonction portait en elle-même une adresse à l’archéologie. Un billet du passé vers le présent, pour se connaître, se reconnaître dans ce qui réapparaît du passé… un saut par dessus un temps écoulé, sans que rien ne se soit passé, pour que quelque chose passe du passé…
Main
tenant le passé,
ce titre-rébus, qui sert d’icône au projet, s’applique singulièrement au travail de l’archéologue, qui, littéralement, par le truchement des objets anciens qu’il saisit, tient en main le passé qu’il « fabrique » pour nous, êtres humains (les archéologues préféreront ici le mot « interpréter » que « fabriquer »).
Archéologues et artistes ont ici accepter de mettre en parallèle, de manière expérimentale et ludique, la manipulation des objets du passé, pour les premiers avec un processus de création fondé sur la manipulation d’objets du quotidien pour les seconds. Or ces deux processus relèvent tous deux de la fabrication du sens : construction d’un récit, correspondant aux conclusions que l’archéologue peut tirer de l’étude des objets du passé de l’humanité, et construction de séquences, fictions spectaculaires, à partir d’objets contemporains pour l’artiste.
L’archéologue, en saisissant les objets, leur confère cette possibilité d’un passé, possibilité commençant à l’instant où leur main a saisi l’objet ; il construit aussi le futur archéologique de l’objet, son trajet de “conservation”. Mais son rôle est aussi de fabriquer, reconstruire, le passé qu’une autre main humaine, il y a parfois des milliers d’années, a conféré à cet objet : la main de l’archéologue n’est pas la première à passer par là. La main de l’archéologue pose une sorte de dérivation, bifurcation, sur le destin de l’objet saisi, un nouveau futur, relativement à la destination donnée par la main de l’homo sapiens qui le tint (et le lâcha…). L’objet ne fera plus ce qu’une première fois il avait été destiné à faire : il “dira” désormais, dans une vitrine, une communication, ce qu’il avait été destiné à faire, après la longue période d’oubli (retour au présent) s’achevant pas l’invention de l’archéologue. L’objet devient le sujet d’un récit, un récit scientifique.
L’artiste manipulateur, en saisissant les objets du quotidien, produit cette même dérivation, bifurcation, dans la destination de l’objet. Sa main en poussant les objets dans une fonction de mot (puisque les objets vont se mettre à exister les uns en fonction des autres et non pas seulement en fonction de leur destination première, leur fonction propre d’outil, d’accessoire, fonction qu’ils ne perdent aucunement d’ailleurs), la main de l’artiste, donc, inscrit les objets dans un autre passage, une autre mémoire, un futur inconnu… fiction… une échappée voisine, dans la forme, à celle que produit la main de l’archéologue, avec des procédures, des choix, certes différents. Mais une échappée qui aboutit elle aussi à une forme de récit, poétique lui.
Enfin, les archéologues sont, en partie, détenteurs des hypothèses portant sur la fonction de la main dans l’apparition du langage humain, avant même que celui-ci migre vers les organes de la phonation, qu’il aurait investi, seulement dans un second temps, comme par contamination des gestes de la main (ce que semble devoir confirmer certains neuro-scintifiques aujourd’hui).
Pierre Fourny