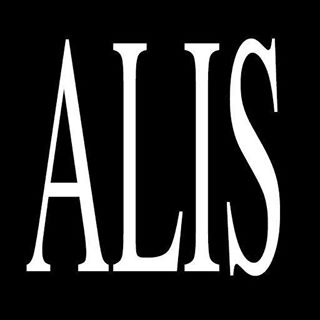LA LANGUE ET SES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES
Jouer avec la langue
Jouer avec la langue, ses mots et ses lettres, est un exercice intellectuel passionnant et les plus grands auteurs se sont intéressés à la création de tautogrammes, holorimes, contrepèteries et autres triturations, de François Rabelais à Alphonse Allais, de François Villon à Umberto Eco.
L’Ouvroir de Littérature Potentiel (OuLiPo) a érigé en art littéraire l’utilisation et l’étude systématique de ces triturations, couramment désignées sous le mot de contraintes. La Table des Opérations Linguistiques Littéraires Élémentaires (dite TOLLÉ), conçue par Marcel Bénabou propose un inventaire de ces contraintes ayant trait aux simples « objets linguistiques » comme la lettre, ou la syllabe jusqu’aux plus complexes « objets linguistiques » comme la phrase ou même le paragraphe (« La règle et la contrainte », Pratiques, n° 39, octobre 1983, 101-106). La Table propose ainsi plus de vingt transformations relatives aux seules lettres dans un mot !
Regarder les mots écrits comme des images
Le grand typographe Massin, littéralement amoureux d’alphabet, rappelle dans une somme encyclopédique, La lettre et l’image (Gallimard, 1970, réédité en 1993) que les lettres ont d’abord été des images et que tous les alphabets latins se sont efforcés de retrouver des dessins parlants, des signes-choses, des lettres-objets (fleurs, animaux…). Il souligne que Platon demandait déjà, par la bouche de Socrate, que les lettres eussent une ressemblance avec les choses. Plus tard, Heumpty Deumpty (parfois traduit par Rondu-Pondu en français) dira à Alice, dans le roman de L’autre côté du miroir de Lewis Carroll : « Mon nom signife la forme que j’ai ».
La transformation des lettres elles-mêmes, produisant de nouvelles images, fait l’objet d’une créativité intense de la part d’auteurs, de dessinateurs, de typographes… On pense à tous les alphabets cryptographiés aux tracés réinventés, tel l’alphabet dansant d’Edgar Allan Poe au XIXème siècle, pour n’en citer qu’un, ou plus proche de nous, à l’étonnant travail d’écriture syllabique francophone d’Olivier Monné, intitulé Linéaire Z. On ne peut manquer de citer Pierre di Sciullo qui continue aujourd’hui d’inventer des polices de caractères à contraintes spécifiques : le Paresseux qui arrive à produire par symétrie et rotation, les 26 lettres de l’alphabet et les 10 chiffres, avec seulement 9 formes de base ! Ou encore le Basnoda (police « symétrisée ») pour permettre la lecture de palindromes verticaux, retournables ligne à ligne.
Et nombreux sont les jeux de mot s’appuyant sur les images : calligrammes, dingbats, rébus, anamorphoses, réarrangements dans l’espace, lecture subliminale. Toutes ces figures sont amplement utilisées aujourd’hui jusque dans la publicité.
Chercher les formes cachées dans les structures les plus diverses
Tous ces jeux révélant ce que la lettre contient d’image ou faisant se rencontrer les mots écrits et les images (ayant souvent à voir avec les mathématiques, la géométrie…) ne produisent pas que du divertissement, ils vont toucher à des associations, des combinaisons auxquelles nous n’avons
plus accès, trop habitués à d’autres logiques.
Ces jeux sont aussi poétiques et nous font basculer dans des mondes perdus ou insoupçonnés.
C’est ce que rappelle l’anthologie poétique de Jean-François Bory, Calligrammes & Cie, etcaetera (Al Dante, 2009), recueil d’explosions typographiques et d’expérimentations poétiques.
La quintessence de l’histoire de ces mots-images peut également être trouvée dans la compilation de Jérôme Peignot Typoésie (Imprimerie Nationale, 1993) .
Une contribution non négligeable est apportée par Douglas Hofstadter, dans Gödel, Escher Bach : les Brins d’une Guirlande Éternelle (InterEditions, édition originale 1979, traduction en français 1985). L’auteur, philosophe et spécialiste des sciences cognitives, étudie les mécanismes de la pensée qui l’amène, par analogie, à discerner et à comprendre les formes cachées dans les structures les plus diverses, tel ce cube ajouré dont les 3 projections horizontale, frontale et verticale sont respectivement G, B et H, ou un palindrome musical dans L’Offrande Musicale de Jean-Sébastien Bach ou encore les premiers ambigrammes de Scott Kim.
Mais toutes ces triturations de lettres et de textes qui leur sont attachés souffrent parfois d’un défaut inhérent à leur support à deux dimensions : impossible à animer, on doit pour beaucoup d’entre elles faire de gros efforts pour imaginer les transformations à l’oeuvre.
À travers ses mises en scène, dans l’espace et le temps, Pierre Fourny joue avec la langue, regarde les lettres de l’alphabet comme des images et se plaît à traquer le dess(e)in caché des mots écrits, mais il nous fait aussi spectateur du processus de métamorphose.
Alain Zalmanski